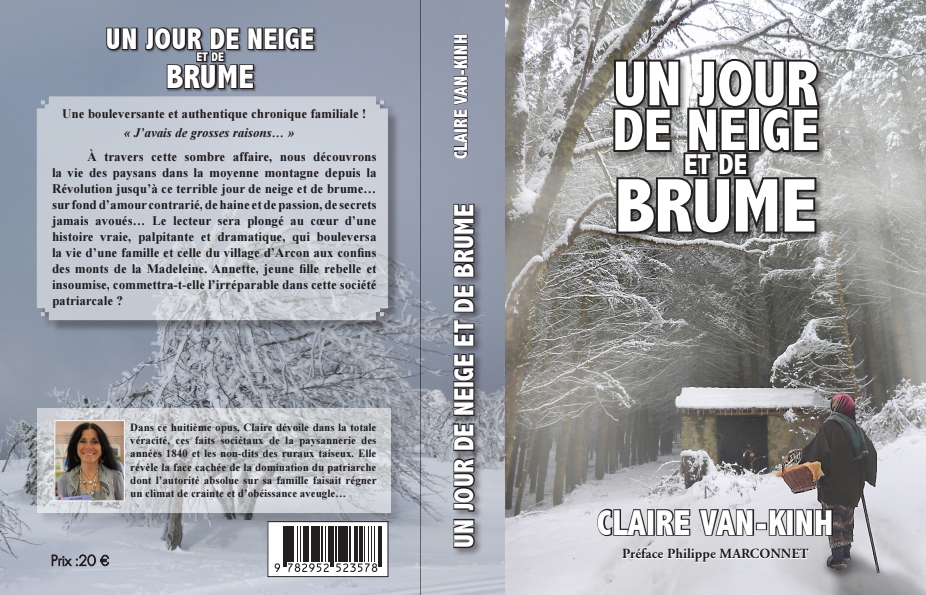
L’obscurité commençait à s’épaissir en ces périodes automnales où la nuit tombait tôt. Il était dix-neuf heures trente. Ce soir-là, comme chaque jour, Jean Dufour se rendit à la ferme voisine, chez son fermier, le père Bancillon.
Ce dernier l’attendait toujours et ensemble ils discutaient de choses et d’autres en buvant quelques bons canons tirés de frais au tonneau.
Comme à l’accoutumée, ils s’attablaient tranquillement et Dufour, en patron attentif à ses biens, s’informait sur les travaux effectués ou ceux à venir, la santé du bétail ; ils projetaient les sorties pour tomber du bois, échangeaient leurs points de vue. Les deux hommes se comprenaient plutôt bien et les discussions aboutissaient le plus souvent sur un terrain d’entente réciproque. D’ailleurs Bancillon n’était que le fermier, donc !
Or à l’extérieur de la maison, une solide silhouette tapie dans une saillie (un coin) du mur, attendait patiemment. Annette. Oui, Annette se tenait là, cachée, un fusil à la main. Son beau-frère, Claude Bouffaron lui avait donné l’arme le matin même après l’avoir chargée de deux cartouches. Comme convenu, ils s’étaient retrouvés vers le jardin :
Annette tenait l’arme dans ses mains moites malgré la fraîcheur de cette fin d’octobre. Elle ne bougeait pas, son cœur battait la chamade, sa gorge nouée comme dans un étau s’asséchait au point de gêner la déglutition. Sur son front perlaient des gouttes de sueur froide qu’elle essuyait d’un geste nerveux. Elle essayait de se maîtriser, mais que cette attente devenait donc insupportable ! Alors elle cherchait une respiration bloquée au fin fond de sa poitrine atrocement douloureuse. Ses jambes flageolaient par moments et de longs frissons lui parcouraient le corps. Dieu que passer à l’acte était donc difficile ! Toute la journée, elle n’avait eu de cesse de tourner et retourner la scène dans sa pauvre tête, depuis la messe dominicale à Arcon où elle cherchait encore du réconfort, jusqu’au dernier moment… Elle remontait le temps…
… Le matin, en revenant de l’église avec son beau-frère, alors qu’ils échafaudaient leur plan, puis le moment où il lui remit le fusil… le repas à midi, à table avec son père face à elle… sa mère et son petit Pierre et sa Louise… Aurait-elle le courage ? Elle essayait de visualiser la scène, celle qui mettrait un terme à ses tourments. Elle se taisait. Elle le regardait manger sa soupe sans mot dire. Son estomac se nouait à chaque instant davantage.
Oui, il le faut ! J’ai de grosses raisons… Que pouvait donc cacher ces quelques mots ?
Quels travaux effectua-t-elle cet après-midi-là ? Elle ne s’en souvenait même plus. D’ailleurs quelle importance ? Elle se tenait ici, dans ce coin de ferme, un fusil à la main et dès que son père…
Oui, dès qu’elle pourrait, elle appuierait sur la queue de détente. Ne pas le rater surtout ; faire attention de ne pas blesser une autre personne ; ne pas s’affoler ; se méfier en appuyant sur la détente du deuxième coup ; Claude l’avait mise en garde, il est plus dur. Elle se remémorait le guet-apens raté du mois de juin. Ne pas commettre la même erreur. Viser. Tirer. C’est tout. Comme ça, froidement sans réfléchir. Viser. Tirer. Viser…
À cet instant, elle entendit le bruit du loquet de la porte de la cuisine, le frottement du bas de celle-ci sur le sol en terre battue et le grincement des gonds. La voix audible des deux hommes se fit plus distincte :
– A r’vère Jean, à d’man ; bouna neu. (au revoir Jean ; à demain ; bonne nuit).
– Bouna neu…
Une pâle lueur filtra dans l’entrebâillement et une silhouette se dessina dans la pénombre.
Alors, Annette bondit…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Claude descendit de la voiture ainsi que ses compagnons d’infortune.
Saisis par une chaleur inhabituelle pour eux, ils respirèrent longuement ce bon air pur après les odeurs nauséabondes du trajet. Gageons que l’impression devait être incroyable pour ces hommes qui découvraient un univers totalement inconnu pour eux ! Mais les garde-chiourmes ne leur octroyèrent pas le temps de rêvasser. D’ailleurs, en éprouvaient-ils l’envie ? Le sort qui les attendait ne serait guère réjouissant. Ils le savaient.
En 1836 le bagne de Toulon comptait 4305 détenus, 1193 condamnés à perpétuité, 174 à plus de vingt ans, les autres purgeaient des peines plus courtes.
Ces forçats ne faisaient plus office de rameurs comme au temps des galères, mais étaient employés à des travaux de force, de terrassement, de construction, dans l’arsenal et même en ville.
Ils furent dirigés sans ménagement dans les immenses locaux dominant la rade.
Aussitôt arrivés, après une fouille minutieuse, les condamnés durent se laver dans des grandes bailles avant qu’un bagnard officiant comme coiffeur ne leur fasse une tonsure réglementaire, avec des raies asymétriques pour les condamnés à temps, rasés avec des raies pour les perpètes.
Sous une tente dressée pour servir de bureau au commis de marine chargé de la visite des condamnés sous l’inspection des commissaires, tout se passait dans un ordre parfait. Chaque homme se dépouillait des habits qu’il portait et pouvait les vendre à quelques passants et conserver une certaine somme d’argent à condition qu’elle ne dépasse pas un plafond fixé par l’administration.
Lors de son inscription, Claude suivit les recommandations de son codétenu à la prison de Montbrison. Si jusqu’alors il se déclarait paysan ou journalier, là, il se ravisa :
- – Je suis menuisier, déclara-t-il…

